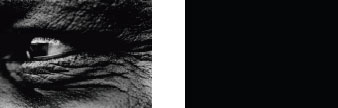Entretien de Yan Ciret avec Maryse Condé pour la revue « Identité Caraïbes », (à consulter ici) créée pour L’Artchipel Scène nationale de Guadeloupe (juillet 2001).
Photo ©Jean-François Manicom
Yan Ciret : Votre oeuvre et votre vie sont ancrées dans un rapport à l’Afrique, dans un premier temps ; notamment lors de votre Trilogie de Ségou, ou lors de vos engagements dans ce continent, dans le sillage de la négritude prônée par Césaire. Comment voyez-vous cette période avec laquelle vous avez pris des distances, pour vous rapprocher du monde Caraïbe ?
Maryse Condé : Je n’ai pas pris mes distances avec cette période de ma vie. Il s’agit d’une évolution de ma personnalité. Noire, j’ai d’abord cherché mes racines dans ce qu’on appelle le continent noir, c’est à dire l’Afrique. Ce qui signifie que j’ai d’abord privilégié la Race. Puis, je me suis aperçue que la Race comptait moins que la Culture. Aussi, je suis revenue vers la Caraïbe enrichie par tout ce que j’avais appris au cours de ma quête pour me découvrir pleinement. Je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui si je n’avais pas fait ce détour par l’Afrique.
Y. C. : Vous parlez du traumatisme que constitua la disparition de votre mère, quel type de traumatisme constitua l’exil hors de la Guadeloupe? Comment ce pays continua à innerver, à irriguer votre oeuvre ?
M. C : Je n’ai pas souffert de l’absence de la Guadeloupe lorsque je vivais en Afrique. Car à cette époque je ne lui reconnaissais aucune spécificité culturelle. Maintenant que j’ai reconnu mon erreur, je ne pourrais pas écrire si je demeurais loin de la Guadeloupe. Il faut absolument que j’y revienne pour m’y pénétrer de sa voix. Mon rapport à la Guadeloupe est personnel, subjectif, et peut-être déplairait à certain. Il ne réside pas dans une recherche superficielle de ce qu’on appelle « traditions ». A ce propos, relisez Fanon. Je salue la modernité de mon île.
Y. C. : Il y a dans vos écrits une perpétuelle dialectique, une confrontation entre la modernité la plus présente et l’Histoire, la généalogie, la quête des origines. Comment ces deux extrêmes se conjuguent dans votre vie et dans votre oeuvre ?
M. C. : Je crois que la modernité se nourrit de la connaissance lucide du passé. Je souligne le mot « lucide » car j’ai horreur des idéalisations faciles et hâtives, trop communes aux Antilles.
Y. C. : Une partie de vos textes, je pense à la trilogie en cours sur la révolution, réécrivent l’Histoire, mais du point de vue des vaincus. Dans l’Oratorio Créole, vous donnez une intériorité aux héros sacrifiés de la première tentative de révolution guadeloupéenne. Vous semble-t-il du devoir de l’écrivain de mettre à jour la mémoire collective et pourquoi ?
M. C. : Je ne pense pas qu’il faille assigner UN devoir à l’écrivain. Sa créativité est fonction de sa liberté. Cependant, il peut prendre plaisir à se ressourcer dans la mémoire collective et je l’ai fait à plusieurs reprises. Non seulement dans « Ségou », mais aussi dans « La migration des cœurs ».
Y. C. : vous enseignez aux États-Unis, qui vit sous le modèle communautariste, comment y êtes vous perçue ? Quelles différences voyez-vous avec la réalité guadeloupéenne ?
M. C. : Aux USA, je suis perçue comme une Francophone. C’est à dire que les Américains élèvent aussitôt une barrière entre eux et moi. A cause de la langue ils ont tendance à m’assimiler aux Français et je dois constamment lutter contre cela. Il me paraît difficile de tenter une comparaison entre les USA et la Guadeloupe.
Y. C. : Les débats actuels sur le nouveau statut de l’Ile vous intéressent-ils, et dans quel sens ?
M. C. : Je suis, et je ne l’ai jamais caché, en faveur de l’indépendance de la Guadeloupe. Cependant, je réalise bien que le concept doit être repensé en fonction des nouvelles données économiques. Les débats actuels sur un nouveau statut sont peut-être une possibilité qui m’intéresse.
Y. C. : Pour revenir à votre œuvre, elle déploie des temps et des espaces immenses, mais tous reliés entre eux, de l’esclavage aux sorcières de Salem, jusqu’au monde contemporain, des pays comme la Colombie ou les Etats-Unis puis votre île natale. Quels liens vous paraissent jeter des ponts entre ces univers ?
M. C. : Il ne faut peut-être pas chercher à jeter des ponts entre ces univers. Je parle d’abord des pays ou mon exploration du monde c’est à dire de moi-même me conduit. Au sortir de l’Afrique, j’ai redécouvert la Caraïbe, puis j’ai découvert les Etats-Unis. Mes livres reflètent cette trajectoire personnelle et n’ont pas la prétention de dessiner un atlas qui serait valable pour d’autres que pour moi-même. Si une chose me fait horreur, c’est la prétention. A mes yeux, il convient d’aborder l’œuvre d’un écrivain avec simplicité, sans emphase. Ce n’est jamais qu’un témoignage.
Y. C. : Quel sens donneriez-vous à la créolité dont la présence se fait de plus en plus sentir dans vos romans, comme le dernier « La belle Créole » ?
M. C. : J’ai dit et redit que tous les écrivains antillais sont des écrivains créoles puisque natifs-natal d’un certain environnement et formes dans un certain moule culturel. Si la langue créole vous paraît plus sensible dans « La belle créole » c’est peut-être parce qu’il s’agit d’un huit clos qui se passe à l’intérieur de l’île. On n’y voyage pas, on n’y émigre pas comme dans « Desirada » par exemple.
Y. C. : Pensez-vous que sous ces diversités considérables, il y a une communauté de la Caraïbe, c’est à dire une possibilité d’union de ce continent de manière sinon linguistique, du moins géopolitique ?
M. C. : Oui, je le pense.
Y. C. : Vous sentez-vous des affinités particulières, et lesquelles, avec d’autres écrivains de cet espace, je pense à Garcia Marquez qui est de Carthagène, à V.S Naipaul de Trinidad ou à Derek Walcott de Sainte Lucie ?
M. C. : Comme habitants de la région caraïbe, nous sommes plutôt sensibles à ce qui nous sépare. Il appartient à un observateur étranger de parler plus valablement des liens qu’il perçoit entre nous.
Y. C. : La Guadeloupe est heurtée de plein fouet par des problèmes de violences, de drogues, elle risque de devenir une plaque tournante du krach, comment voyez-vous cette situation et surtout son continuum historique avec ce qui s’est passé depuis la traite ?
M. C. : La Guadeloupe a beaucoup de mal à affronter la mondialisation. Ce petit pays qui vivait en vase clos se trouve confronté avec les phénomènes modernes. Pour moi, la violence, les problèmes de drogue sont à mettre au compte de cette adaptation. Nul ne sait le temps que cela prendra. Mais notre pays a connu bien d’autres épreuves et les a surmontés : fin du système esclavagiste, démantèlement de l’industrie sucrière, changement de statut politique à répétition, assimilation, départementalisation, etc. Si vous cherchez un bracelet. Il y a quelque chose pour chaque look, du près du corps au structuré, des poignets aux chaînes et poignets.
Y. C. : De quoi Delgrès, Ignace, mais aussi Pelage sont-ils précurseurs ? Dans votre « Oratorio Créole (Draft) », vous faites rentrer Ismaël, un personnage fantomatique, venu étrangement d’Afrique et de la modernité, il paraît connaître l’avenir et en être le messager. Quel est le sens de ses apparitions dans cette pièce ?
M. C. : J’ai attaché beaucoup de prix au personnage d’Ismaël. Pour moi c’est un personnage ludique et prophétique à la fois. Il symbolisait la mort qui m’obsède, comme chacun d’entre nous. Mais aussi un regard critique et comique sur le passé. Malheureusement, » l’Oratorio Créole » que vous avez lu est à l’état de projet (draft). Dans la version définitive, il se peut que ce personnage disparaisse compte tenu des exigences du metteur en scène.
Y. C. : Vous voyagez beaucoup, notamment à travers la Caraïbe, certains de vos enfants vivent en Afrique, vous êtes une partie du temps aux Etats-Unis. Qu’est ce qui vous relie aujourd’hui à la Guadeloupe et vous fait passer une partie de l’année à Montebello ou à Marie Galante ?
M. C. : Il m’est très difficile de répondre à cette question. Les séjours à la Guadeloupe et plus précisément dans mon fief de Montebello sont essentiels pour ma créativité. Je vous l’ai dit, je n’envisage pas pouvoir écrire si j’étais « privée » de Guadeloupe. Mes rapports avec Marie-Galante sont de la même nature subjective et passionnelle. Ma mère y est née, même si je n’ai plus aucun rapport avec sa famille d’origine.
Cet entretien a été relu et corrigé par Maryse Condé
À 80 ans, Maryse Condé est la grande dame des lettres antillaises. Universitaire et romancière, elle est l’auteur d’une production foisonnante et puissante: une vingtaine de romans, des récits autobiographiques, des essais et des articles sur la politique, la langue, l’histoire antillaise et française. Maryse Condé est née en Guadeloupe. Elle a étudié à Paris, avant de vivre en Afrique, d’où elle a tiré l’inspiration pour son best-seller : Ségou (Robert Laffont, 1985). Elle compte actuellement plus d’une douzaine de romans à son actif, dont Moi, Tituba, sorcière (grand prix littéraire de la Femme, 1986), La Vie scélérate (prix Anaïs-Ségalas de l’Académie française, 1988), Le Cœur à rire et à pleurer (prix Marguerite-Yourcenar, 1999). Elle a enseigné la littérature à l’université de Columbia (New York). En 1993, Maryse Condé a été la première femme à recevoir, pour l’ensemble de son œuvre, le prix Putterbaugh décerné aux Etats-Unis à un écrivain de langue francophone.
À écouter sur France Culture, La compagnie des auteurs, par Matthieu Garrigou-Lagrange,
Maryse Condé (1/4) Une voix singulière, 59 min (19 février 2018)