Avec ce texte de l’écrivain Mario Vargas Llosa, sur la pièce Angels in America de Tony Kushner, « Cosmos » commence la publication de textes inédits, ou rares voire non traduits. Celui-ci du Prix Nobel de littérature 2010 a été publié dans « La Revue du Théâtre de la Bastille n°5 » titré « Un monde blanc » (dir. Yan Ciret), janvier 1995. On pourra mesurer la haute générosité de cet immense écrivain. L’auteur de « La ville et les chiens », et autres chefs-d’œuvre, débute une série qui verra la publication de textes d’écrivains tels que Sony Labou Tansi, Salman Rushdie, Alvaro Mutis, Allen Ginsberg. Il est a noter l’entrée au répertoire de « La Comédie Française » (2019-2020) de Angels in America, dans la mise en scène du cinéaste Arnaud Desplechin.
——–
Sans être une figure de premier plan, l’avocat Roy M. Cohn fut aux Etats-Unis l’un des artisans les plus influents de la chasse aux sorcières, aux temps ignominieux du sénateur Mc Carthy, marqués par une paranoïa anticommuniste et moralisante qui dévasta Hollywood, les théâtres de Broadway et introduisit censure et autocensure dans les moyens de communication. Bras droit de Mc Carthy, il opérait dans l’ombre, en orientant les recherches sur des espions présumés, en intriguant pour installer aux tribunaux et aux postes clés de l’administration ses protégés et ses fidèles idéologiques et pour que les juges prononcent des sentences draconiennes contre ses victimes. Ses mauvais artifices, qu’il exerçait avec génie, furent décisifs apparemment dans la condamnation à mort des époux Julius et Ethel Rosenberg.
En même temps qu’il défendait de façon implacable la politique la plus conservatrice et les bonnes mœurs, Roy M. Cohn menait une vie secrète, d’homosexuel, et mourut du sida en 1986. Tony Kushner recrée sa vie dans Angels in America à partir du moment où le puissant avocat new-yorkais apprend qu’il a contracté la maladie et, sans renoncer le moins du monde à ses convictions ultras, il meurt à petit feu, soigné par un infirmier noir, tapette et travesti, appelé Belize, et épié par le fantôme vengeur d’ Ethel Rosenberg, qu’il voit ou imagine dans les spasmes semi-mystiques qui secouent son agonie, et qui lui chante, quand il expire, une prière funèbre en hébreu.

Roy M. Cohn est le personnage le plus dramatique de l’œuvre, avec sa personnalité tortueuse, sa philosophie darwinienne et ses éclats convulsifs, mais ce n’est pas la figure principale de cette ambitieuse « Fantaisie gay sur des thèmes nationaux » (c’est son sous-titre) qui a remporté tous les prix de théâtre à New York et à Londres et battu tous les records de recette dans les deux villes où elle a été créée. Le héros est le jeune Prior Walter qui, avant de contracter le virus, était, semble-t-il un garçon obscur et sans histoire dans la babylonienne New York, où il vivait avec Louis Ironson, un analyste-programmeur politiquement pontifiant et moralement présomptueux. Mais depuis que le sida commence à saper sa fragile ossature, Prior entend des voix d’outre-tombe, a des visions généalogiques, dialogue avec un ange aux ailes magnifiques, rend visite à la mort et retourne à la vie l’esprit en paix et chargé de sagesse. On y voit aussi déambuler une famille de mormons, dont la très sévère morale vole en éclats sous les yeux du public quand le descendant Joseph Porter Pitt, fonctionnaire de la cour de justice, reconnaît sa vocation homosexuelle, sa femme Harper succombe aux paradis artificiels de la chimie – le valium – et sa mère, Hannah, spartiate matrone qui est venue à Brooklyn depuis Salt Lake City pour sauver son fils Joe du péché, découvre le sexe rien de moins que dans les bras d’un ange (féminin de surcroît).
C’est, bien sûr, un résumé infidèle et un peu raccourci d’une œuvre qui comprend deux spectacles – Le millénaire approche et Perestroïka -, dure sept heures et demi, est l’objet d’une mise en scène merveilleuse et, contrairement à ce qu’on pourrait croire au vu des graves sujets qu’elle traite – le sida, la condition homosexuelle, la religion dans la société contemporaine -, affiche un humour pétillant et varié, parfois sarcastique ou féroce dans ses caricatures, ses flèches, parfois subtile et tendre comme dans les rêveries arctiques de Harper, l’épouse abandonnée, frisant parfois le canular intellectuel (Roy M. Cohn, dans le délire de son agonie, imagine que l’écrivaine Lilian Helman. autre victime du maccarthysme, va l’empoisonner en changeant ses médicaments).
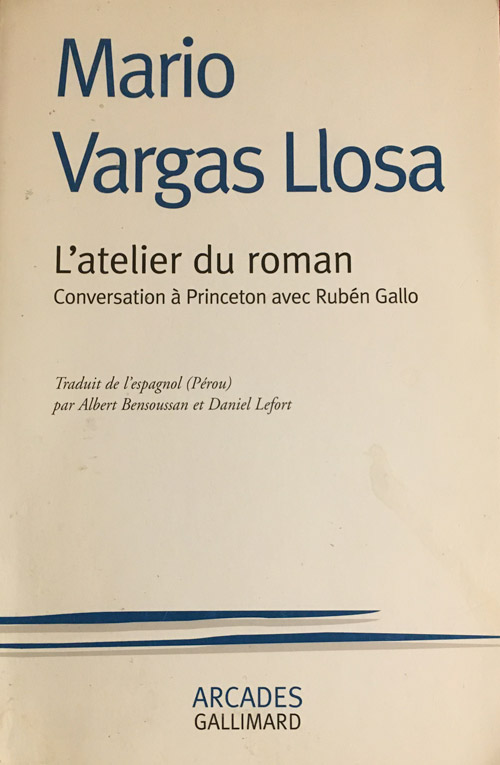
Mais quoique le public rit beaucoup et, grâce à la savante couche d’humour qui les atténue et les distancie, digère sans heurts les évènements douloureux et parfois atroces rapportés dans Angels in America, je crois qu’il serait injuste et trop hâtif de dire que ce n’est qu’une œuvre de divertissement, une excellente représentation qui maintient ses spectateurs, tout le temps qu’elle dure, l’esprit réjoui. Car cette fiction ne veut pas divertir mais agiter et remuer les esprits, ouvrir les yeux des aveugles sur une réalité qu’ils ignorent, stimuler leur vision critique et apporter des idées nouvelles pour la compréhension des problèmes actuels les plus urgents. Dans la tradition de Bertolt Brecht et celle du théâtre existentialiste, Tony Kushner a écrit une pièce qui veut être, à la fois, pédagogique et engagée.
Et c’est pour moi ce qu’elle a de plus précaire et de discutable. Car il n’est pas vrai que le sida soit le problème numéro un de l’humanité, comme ne l’était pas non plus la tuberculose au dix-neuvième siècle, quand elle apparaissait aussi comme une maladie incurable et la sensibilité morbide des romantiques l’avait mythifiée et magnifiée artistiquement d’une manière très semblable à celle qu’emploient pour parler du sida des films comme Les nuits fauves, de Cyril Collard ou des pièces de théâtre comme Angels in America. En les voyant, il semblerait que ceux qui sont infectés par ce virus qui condamne à une mort lente et atroce, ne sont pas des victimes mais des élus, des êtres que la souffrance physique indicible et le fait de se savoir condamnés spiritualisent et sanctifient.
Tel est le message qui se dégage de l’extraordinaire transformation qui s’opère chez Prior Walter depuis qu’il révèle à Louis qu’il appartient à « l’ordre lésionnaire » jusqu’à ce que, cinq ans plus tard, dans la scène finale, il revendique avec un certain orgueil la maladie qui, avec l’expiation physique, lui a conféré la sérénité, la connaissance de l’humain et l’appréhension du divin. Le sida a transformé le garçon inoffensif du début en un prophète et un « saint » messianique qui donne des leçons sur la vie et contemple le reste des humains depuis une perspective morale supérieure.
Ceci est religion, non raison, illusionnisme magique au lieu de ce qu’il prétend être : démystification décharnée d’une réalité problématique. Le sida, pas plus que les infections ou des maux physiques moins homicides, n’enrichit l’esprit ou purifie l’âme : c’est toujours une tragédie pour le corps, par conséquent, préjudiciable à la vie intellectuelle et spirituelle. C’est pourquoi on doit le combattre au moyen de la science et non de conjurations et d’exorcismes (surtout par ceux qui, comme l’auteur de Angels in America et ceux qui font la queue trois mois à l’avance pour voir l’oeuvre à Broadway, ne croient pas dans les conjurations et les exorcismes).

L’appel à une approche rationnelle et non fétichiste du problème du sida est d’autant plus urgent qu’autour de ce mal règnent encore des préjugés tenaces de par le monde. Malgré les conclusions des statistiques médicales, beaucoup pensent encore que le virus qui le provoque n’affecte que les homosexuels et des groupes relativement minoritaires (drogués, hémophiles, etc.) ce qui fut certain au début mais est faux maintenant, car le nombre d’infectés parmi les hétérosexuels des deux sexes tend à croître à un rythme qui s’approche, dans tous les pays où il y a des statistiques fiables, de ces secteurs sociaux qui furent les plus frappés au moment de l’apparition du virus. Le « problème du sida » n’est donc pas, rationnellement parlant, le problème des homosexuels – comme semble le suggérer Angels in America – mais celui de toute l’humanité vivante, et ses dégâts peuvent être réduits, par de bonnes campagnes d’information et de pédagogie sur les risques et la façon de les éviter, et en consacrant les ressources nécessaires qui permettent à la science de trouver les moyens de le prévenir et de le guérir. Mythifier le sida avec le halo romantique de l’héroïque et du sacré c’est procéder de la même façon irrationnelle et obscurantiste que ceux qui le considèrent comme un fléau de Dieu contre des pervertis et des vicieux. Ce n’est pas non plus la stratégie la plus efficace pour lutter contre le préjugé et la discrimination dont sont victimes les minorités sexuelles que de mythifier l’homosexualité, en laissant entendre, comme cela se passe dans l’œuvre de Kushner, que celui qui la pratique et la choisit, par les sanctions sociales auxquelles il s’expose et l’incompréhension, voire l’hostilité dont il est inévitablement victime, atteint une forme plus intense d’humanité, une sensibilité plus aiguë à la compassion, la solidarité et la fraternité (c’est ce que personnifie, dans l’œuvre, Belize, l’ex-travesti, qui consacre sa vie à soigner des malades du sida même aussi repoussants que Roy M. Cohn). Et c’est qu’il s’agit d’un mensonge flagrant, comme le sont toutes les classifications de l’espèce humaine qui fondent l’individuel dans le grégaire. La vérité c’est que « l’homosexuel » générique n’existe pas plus que « l’hétérosexuel » spécifique. Il existe des homosexuels et des hétérosexuels et, dans les deux variétés, une telle myriade de sous- espèces et d’exceptions qu’elle invalide d’emblée toute tentative réductionniste et généralisatrice. Comme la race, la religion, la langue ou la culture, le sexe est une donnée parmi bien d’autres qui, en soi, est incapable d’expliquer suffisamment un individu, encore moins une collectivité.
Peut-être ces considérations vont-elles trop loin dans l’analyse d’une œuvre dont le grand mérite n’est pas philosophique ; il est de faire découvrir le bonheur et l’enthousiasme du bon théâtre à un public qui commençait à tourner le dos à la scène. Mais le fait est que Angels in America, outre son habileté théâtrale, révèle une grande ambition et la conviction que cette cérémonie fictive, que le texte dramatique et les acteurs représentent, peut avoir un effet prolongé dans la vie et, à travers les spectateurs éduqués par elle, corriger ce qui va mal, orienter l’histoire. Je ne suis pas bien sûr que ce soient là les pouvoirs ni les devoirs de la fiction, mais, s’ils le sont, il convient que les leçons données par la scène distinguent clairement ce qui relève du mythe de ce qui est la réalité.
New-York, mars 1994 (traduit par Albert Bensoussan).

