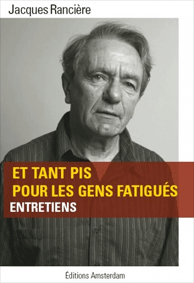Entretien par Yan Ciret (Numéro 258, artpress, juin 2000).
Philosophe du lien entre esthétique et politique, Jacques Rancière publie Le Partage du sensible (éditions La Fabrique), un livre clef qui récuse les dramaturgies de la fin de l’histoire tout autant que les « retours à » réactionnaires. Au-delà des débats sur la crise de l’art la mort de l’image, la fin des idéologies, c’est l’inscription des pratiques artistiques dans un découpage des temps et des espaces, du visible et de l’invisible de la parole et du bruit, qui est recherchée. Sa lecture de l’histoire à travers la fiction, son analyse de la modernité hors des catégories, font de cette pensée l’un des espaces d’intelligibilité de l’art actuel.

Yan Ciret : Dans votre dernier livre, Le Partage du sensible, vous mettez radicalement en crise le concept de modernité et celui d’avant-garde. En quoi cette structure élaborée à la fin du 19e siècle par Baudelaire, reprise par Walter Benjamin, jusqu’aux situationnistes et Tel Quel, vous paraît-elle invalide ?
Jacques Rancière : Je ne m’inscris pas dans une querelle des anciens et des modernes. Je m’en suis pris à la notion de modernité comme catégorie explicative, maniée aussi bien par les partisans et par les détracteurs de l’art contemporain. Celle-ci introduit un rapport problématique entre le cours de l’Histoire et le devenir de l’art. D’abord, elle identifie abusivement les transformations de l’art à des ruptures exemplaires : par exemple l’abstraction picturale ou le ready-made qui sont des formes particulières d’un paradigme ante-représentatif beaucoup plus général. Ensuite, elle assimile la rupture ainsi construite à l’accomplissement d’une tâche politique ou d’un destin historique de l’époque Cela me paraît relever d’une onto-théologie générale qui pose un grand signifiant-maître capable de gouverner une époque. Ce concept a fini par noyer l’art dans un mélodrame pathétique qui mêle le sublime kantien et le meurtre du Père, l’interdit de la représentation et les techniques de la reproduction mécanisée, la fuite des dieux et l’extermination des Juifs d’Europe. J’ai voulu sortir de ce pathos pour identifier, à la place de déterminations métaphysiques de l’époque, des régimes spécifiques de l’art.
Nouvelle visibilité de l’art
Y.C. : Comment expliquez-vous que ce pathétisme du moderne ait correspondu avec une libération d’énergie aussi intense, et que le 20° siècle reste comme l’un des sommets de l’histoire de l’art, avec une déflagration d’œuvres, telles que celles de Joyce, Stravinski, De Kooning, Picasso, Eisenstein ?
J.R. : Ce n’est pas le pathos de la modernité qui a ouvert l’art à l’infini des possibles, mais la destruction des catégories, frontières et hiérarchies du régime représentatif de l’art. J’essaie d’inscrire cette ouverture dans la définition d’un régime esthétique de l’art défini comme ensemble de rapports entre le voir, le faire et le dire. C’est cette transformation qui permet les œuvres dont vous parlez et qui permet des combinaisons inédites, à partir de la rupture d’un certain nombre de frontières qui séparaient les arts entre eux ou les formes de l’art des formes de la vie, l’art pur de l’art appliqué, l’art du non-art, le narratif du descriptif et du symbolique. Ce sont de nouvelles formes de visibilité de l’art que l’on ne doit pas contraindre à rentrer dans un grand signifiant global, surplombant, comme celui de modernité.
Y.C. : Justement, cette modernité s’est toujours constituée sur la rupture, le culte du nouveau, le progrès, aussi bien politique qu’esthétique. Il y avait une scène primitive pour cette modernité, celle du régicide-parricide, de la Révolution. Ne croyez-vous pas que la mélancolie actuelle des avant-gardes exprime la perte de cette scène ?
J.R. : Je ne crois pas que les transformations de l’art doivent se penser sur cette unique ligne du régicide-parricide, de la rupture infinie. Depuis le romantisme, la nouveauté esthétique n’a cessé de s’associer à des formes de réinterprétation de l’ancien. La rupture a toujours été une reprise, une réinscription, et aussi une manière de mettre dans l’art ce qui n’était pas de l’art : des objets de l’anthropologie, de l’imagerie, des choses de la nature. Il nous faut sortir du schéma du penseur de la fin de l’Histoire. L’art vit depuis deux siècles de remises en question constantes des frontières entre ce qui est nouveau et ce qui est ancien, de remises à disposition des images, en faisant entrer dans l’art ce qui ne relevait pas de ses catégories, en recyclant des clichés.
Y.C. : Vous ne croyez donc pas à une «théorie des exceptions» (1. qui ferait qu’en art une expérience singulière par sa radicalité novatrice peut déplacer un champ esthétique, créer une brèche imprévisible ?
J.R. : Non, le changement se fait à travers une multitude de petites effractions. On reconstitue toujours une histoire de l’art rétrospectivement avec de grandes effractions majeures. Comme si Kandinsky ou Malevitch, un seul tableau même, avaient été des révolutions dans l’histoire de l’humanité. Avec Kandinsky, on n’identifie plus les signes colorés sur la toile avec la figuration d’aucune chose du monde. Mais cette désidentification avait déjà été pratiquée à la fin du 19e siècle par les théoriciens du symbolisme. Ils voyaient déjà sur des tableaux figuratifs, ceux de Gauguin par exemple, des combinaisons abstraites de formes et de signes. Ces espèces «d’événements», il faut les resituer dans des contextes plus larges au lieu de se polariser sur quelques grandes ruptures. La moitié de ceux qui écrivent sur l’art moderne font comme si le Grand Verre de Marcel Duchamp avait été une coupure en deux de l’histoire de l’humanité. On doit inscrire le Grand Verre dans toute une série de transformations des idées et pratiques de l’art, de rapports entre art pur et art appliqué, art et non-art. Il ne faut pas écraser tout un paradigme esthétique avec quelques grandes figures que l’on va doter d’un pathos métaphysique, destinal.
Y.C. : L’envers d’une «théorie des exceptions», on la trouve dans votre livre Aux bords du politique, sous la forme d’une «communauté des égaux». Cela m’a fait penser au communisme littéraire dont parle Jean-Luc Nancy. Mais que serait dans un régime esthétique une communauté des égaux ?
J.R. : S’il y a une communauté des égaux en art cela ne passe pas par la constitution de sujets collectifs correspondant à des groupes réels. Les sujets d’une communauté des égaux en politique, ce sont d’abord des formes d’énonciation, de manifestation. Il s’agit de la même chose en art. S’il y a égalité, cela passe par une forme d’anonymat de l’art. Cela se joue dans l’inscription des œuvres dans un monde d’égalité. C’est-à-dire un monde où la frontière de l’art et du non-art est une frontière jamais constituée, sans cesse retracée. De même que l’on retrace des lignes de discernement, de séparation, entre la politique et ce que j’appelle la police, l’art va effectuer de multiples transgressions par rapport aux modes d’esthétisation de la vie, mais aussi aux critères intégristes de la séparation des genres. Mais ce sont de petits écarts qui ne vont plus revendiquer la grande exception de l’art. Une communauté des égaux passant par l’art serait une communauté de ces actes qui créent de légères différences, une ligne de distinction qui n’aurait pas de critères institutionnels de reconnaissance.
Y.C. : Deux figures d’artistes me paraissent majeures aujourd’hui. L’une que vous identifiez dans un texte de la revue Trafic, «Fiction de mémoire», à propos d’un film de Chris Marker, serait la figure du tombeau, du deuil. Ce sont les derniers textes de Serge Daney, les Histoire(s) du cinéma de Godard, ce que vous appelez le «poème du poème». De l’autre côté, de très jeunes artistes en deuil de cette scène de rupture que j’évoquais s’auto-sacrifient, s’exhibent en martyrs, avec une consomption des corps. Il y aurait donc deux grandes figures de l’art, celle du tombeau et celle de la victime ?
J.R. : Ces deux figures n’en font qu’une. Dans les deux cas, fondamentalement, c’est l’identification du processus de l’art à l’histoire des signes inscrits sur les corps. Je séparerais cela d’une scène sacrificielle première. Ce que j’ai toujours essayé de faire en esthétique comme en politique, c’est de mettre de côté une telle scène. C’est la fin d’ Œdipe à Colonne : pour que la démocratie existe, on ne doit plus savoir où se trouve le corps du sacrifice. Les deux figures que vous identifiez sont deux figures d’histoire. Le «Poème du poème» remonte au Wilhelm Meister de Goethe, lu par Friedrich Schlegel comme intégration de toutes les figures de la poésie. Le Tombeau d’Alexandre de Chris Marker ou les Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, c’est exactement cela, des formes de réinscription, de réagencement de signes. L’art autobiographique du corps est une autre forme de lecture de l’histoire à travers la transformation ou l’usage d’un corps. Il s’agit, dans les deux cas, d’un mode de présentation d’une histoire marquée dans un corps, par exposition littérale du corps de l’artiste ou par la constitution d’un corpus de signes. Mais ce ne sont pas forcément des figures de sacrifice ou de deuil. Il y a une identification du travail de l’artiste à un processus d’histoire et de mémoire. Cela traverse l’art depuis deux siècles. Cela part du roman balzacien où l’on déroule une histoire à partir de signes que l’on a lus sur un corps ou sur un mur, cela traverse la période symboliste, le surréalisme qui fait de l’inconscient avec des morceaux de catalogue, cela passe par le pop art et ainsi de suite. Chez Godard, il y a deux choses, une poétique de réagencement des images et des signes mis en disponibilité, et puis un ton funèbre, très fin de siècle, fait de bouts d’ Heidegger, de Debord, de Baudrillard. Ce n’est pas le pathos qui fait la poétique. Le Tombeau d’Alexandre de Chris Marker est un film nostalgique sur l’URSS, mais ce n’est pas un film de la fin de l’art.
Y.C. : Je pense à cette phrase de Daney : «Donnez-nous du deuil», face au «think positive» ambiant. Ne croyez-vous pas que c’est en allant au bout du deuil que l’on bascule sur autre chose et que l’on évite le «retour à» réactionnaire et régressif. Pour vous répondre, le prochain film de Godard doit s’appeler l’Origine du 21e siècle.
J.R. : Pour moi, le travail de mémoire n’est pas un travail de deuil. Je pense que l’on n’est jamais ni dans le deuil intégral, la déréliction, ni dans l’apparition, du nouveau, sous la forme messianique propre à la pensée de Benjamin. Le nouveau, il s’en crée par petites différences, par apparition de nouveaux points de vue, de dispositions inédites d’objets, d’images. Bien sûr, nous venons après un temps où des figures politiques ou métapolitiques grandioses ont abouti à des catastrophes et à des horreurs, d’accord, mais je ne pense pas qu’il faille identifier ce destin politique à un destin général de la modernité, dans lequel seraient prises les figures de l’art. Ces figures, elles apparaissent et elles disparaissent. Ce qu’on appelle crise de l’art, ce sont ces dispositifs nouveaux qui viennent brouiller justement un concept de modernité qui voudrait en rester au carré blanc sur fond blanc de Malevitch. Les artistes sortent les arts de leur «médium» propre, mélangent leurs moyens et les procédures de l’art avec les formes de la vie. Cela donne une situation d’indiscernabilité, mais est-ce que l’esthétique et le politique ne vivent pas de cette indiscernabilité permanente ?
Y.C. : Cet état indiscernable ne mène-t-il pas à ce que vous avez appelé «la gloire du quelconque», une forme de banalité, d’anonymat, quelque chose qui est très présent dans l’art actuel. L’inscription se faisant sur des corps anonymes, presque désidentifiés. C’est un art fait avec des objets déjà là, sans qualité particulière. N’y-a-t-il pas une mise en visibilité nouvelle du quelconque?
J. R. : Oui, c’est constitutif de ce que j’appelle le régime esthétique de l’art, né avec la révocation des grands sujets de l’art. Dès le romantisme, il y a une redécouverte de la peinture de genre, de la nature morte, de Chardin. Il y a une poésie du banal qui s’identifie à la gloire de l’apparaître chez Hegel ou à la poésie du vide chez Flaubert. Et ça n’a pas cessé, cela passe à travers l’impressionnisme, ou le mélange du cirque, de la foire et de la pantomime au début du 20′ siècle. Il y a des stratégies différentes du banal, dans le dadaïsme, comme dans le surréalisme. Cette invasion du banal, on Peut l’utiliser à la Flaubert, à la Kurt Schwitters, à la Andy Warhol. On y déplore aujourd’hui une perte de définition des frontières. Mais c’est dans le monde classique de la représentation que les pratiques de l’art étaient bien séparées au sein des manières de faire, par le critère de l’imitation. Dans le régime de l’art actuel, la séparation passe au sein des manières d’être. Ce que l’on appelle art n’est plus défini à partir de pratiques spécifiques, mais à travers la modalité des objets sensibles produits. Il s’effectue un déplacement qui va caractériser le régime esthétique, un cadrage différent, une pratique sociale déplacée qui rentre dans l’art. Et c’est cela qui va devenir intolérable pour les modernistes, au-delà de l’utilisation de vidéos, d’installations, de moniteurs. Parce que cela dénonce l’identification sournoise opérée par le modernisme entre l’autonomie de l’art et l’artisanat de l’artiste.
Y. C. : Ne vous semble-t-il pas que l’artiste devient un simple opérateur dans le régime esthétique actuel, les nouvelles technologies prenant en charge une grande partie de la subjectivisation artistique ?
J. R. : Effectivement, l’importation dans l’art de toutes les techniques possibles mène à ce que l’artiste ne soit parfois qu’un opérateur. Mais ce n’est aucunement une catastrophe du contemporain, cela renvoie à une détermination essentielle de l’art depuis deux siècles : l’art se définit désormais par l’équivalence entre une forme née d’elle-même et le produit d’un calcul, l’identité d’un processus conscient et d’un processus inconscient, et ceci a été formulé théoriquement par Schelling et par Hegel au début du 19′ siècle. Puis cela a été repris par les arts mécaniques, la photographie, le cinéma Les grands manifestes du cinéma des années 20 prônent l’identité de l’œil de la caméra et de l’œil du cinéaste, c’est ce qui se reloue actuellement dans l’apport des nouvelles technologies.
Y. C. : Ces techniques d’enregistrement sont surtout contemporaines d’un art du témoignage. On nous présente des témoins qu’aucune fiction ne réinscrit plus dans l’histoire. Ces corps peuvent être bosniaques, rwandais, tchétchènes, l’art qui les exhibe n’en dit rien d’autre qu’un simple folklore du malheur, les réduisant à une sociologie d’eux-mêmes.
J. R. : Il est clair qu’il y a deux démarches opposées, l’une qui crée des corps fictionnels qui déroulent des signes constituant une fiction qui marque l’inscription de ces corps dans l’histoire, et puis il y a la démarche qui considère que chaque catégorie d’interprétation du monde a ses témoins L’art du témoignage dont vous parlez suppose qu’il y a des témoins de la douleur C’est un renversement des choses, le témoin est toujours censé être déjà la pour témoigner d’une idée ou d’une catégorie qui, elle, n’est que du document C’est un art qui s’assimile a une gestion banale de l’information Paradoxalement, cette tendance est confortée par le discours post-auschwitzien sur le témoin qui dit, qu’après les camps, il ne peut plus y avoir d’art, mais que des témoins. Il y a une conjonction perverse entre l’ordinaire d’une gestion de l’opinion et cette grande déclaration d’un âge du monde où il ne pourrait plus y avoir désormais qu’un art de témoins Ou les témoins disent ce que l’on sait d’avance qu’ils vont dire je suis le témoin. Ou ils écrivent, peignent, filment, et trouvent une forme de fiction L’écriture de l’Espèce humaine de Robert Antelme ne renvoie à aucune esthétique de l’irreprésentable mais à l’écriture de Madame Bovary. Ou bien le témoin n’est que l’illustration dont on a besoin, ou il est quelqu’un qui parle, qui agit et fait œuvre.
Y. C. : Simultanément à cet art de constat, on voit revenir l’idée de l’utopie, mais sous une forme d’intégration maximale au social, à l’institution. Est-ce que vous ne pensez pas qu’il s’agit là d’une utopie inversée, la part contraire de la révolution, se réalisant dans une fusion sans limite entre l’art, le travail, la communauté, l’humanitaire, le marché, une assimilation des moyens de production au consumérisme, pour aboutir, en fin de compte, à la fin de l’histoire comme terre promise ?
J. R. : C’est une contradiction matricielle du régime esthétique de l’art que de poser en même temps l’autonomie de l’art et son identification à une forme de la vie Cette identification peut se décliner de bien des manières, sur le mode révolutionnaire futuriste, sur le mode de l’intervention critique, du travail de mémoire, de l’esthétisation publicitaire, etc. Il faut sortir du pathos de l’utopie, de sa fin ou de sa banalisation.
1.) « Théorie des exceptions », Philippe Sollers, Gallimard, 1986.
Pour une étude plus complète la « Théorie des exceptions » et « Jacques Rancière et la communauté des égaux ». Voir http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article1629
Publié dans le numéro 258, artpress, juin 2000
Puis repris dans « Jacques Rancière – Tant pis pour les gens fatigués/Entretiens », éditions Amsterdam.
Ensuite dans « Jacques Rancière, Grands entretiens, art press », 2014.